Voyage au bout de la nuit / Путешествие на край ночи. Книга для чтения на французском языке. Луи-Фердинанд Селин
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Voyage au bout de la nuit / Путешествие на край ночи. Книга для чтения на французском языке - Луи-Фердинанд Селин страница 7
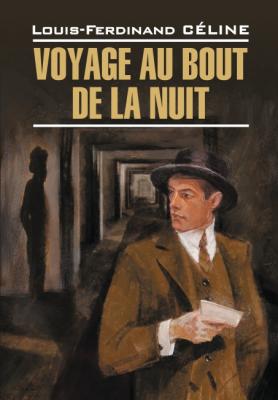 Le général même ne trouvait plus de campements sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en pleins champs, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de cœur l’ont perdu. C’est à partir de ces mois-là qu’on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par escouades, et que le gendarme s’est mis à être cité à l’ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie de vraie.
Le général même ne trouvait plus de campements sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en pleins champs, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de cœur l’ont perdu. C’est à partir de ces mois-là qu’on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par escouades, et que le gendarme s’est mis à être cité à l’ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie de vraie.
Après un repos, on est remontés à cheval, quelques semaines plus tard, et on est repartis vers le nord. Le froid lui aussi vint avec nous. Le canon ne nous quittait plus. Cependant, on ne se rencontrait guère avec les Allemands que par hasard, tantôt un hussard ou un groupe de tirailleurs, par-ci, par-là, en jaune et vert, des jolies couleurs. On semblait les chercher, mais on s’en allait plus loin dès qu’on les apercevait. À chaque rencontre, deux ou trois cavaliers y restaient, tantôt à eux, tantôt à nous. Et leurs chevaux libérés, étriers fous et clinquants, galopaient à vide et dévalaient vers nous de très loin avec leurs selles à troussequins bizarres, et leurs cuirs frais comme ceux des portefeuilles du jour de l’an. C’est nos chevaux qu’ils venaient rejoindre, amis tout de suite. Bien de la chance! C’est pas nous qu’on aurait pu en faire autant!
Un matin en rentrant de reconnaissance, le lieutenant de Sainte‐Engence invitait les autres officiers à constater qu’il ne leur racontait pas des blagues. « J’en ai sabré deux! » assurait-il à la ronde, et montrait en même temps son sabre où, c’était vrai, le sang caillé comblait la petite rainure, faite exprès pour ça.
« Il a été épatant! Bravo, Sainte-Engence!.. Si vous l’aviez vu, messieurs! Quel assaut! » l’appuyait le capitaine Ortolan.
C’était dans l’escadron d’Ortolan que ça venait de se passer.
« Je n’ai rien perdu de l’affaire! Je n’en étais pas loin! Un coup de pointe au cou en avant et à droite!.. Toc! Le premier tombe!.. Une autre pointe en pleine poitrine!.. À gauche! Traversez! Une véritable parade de concours, messieurs!.. Encore bravo, Sainte-Engence! Deux lanciers! À un kilomètre d’ici! Les deux gaillards y sont encore! En pleins labours! La guerre est finie pour eux, hein, Sainte-Engence?.. Quel coup double! Ils ont dû se vider comme des lapins! »
Le lieutenant de Sainte-Engence, dont le cheval avait longuement galopé, accueillait les hommages et compliments des camarades avec modestie. À présent qu’Ortolan s’était porté garant de l’exploit, il était rassuré et il prenait du large, il ramenait sa jument au sec en la faisant tourner lentement en cercle autour de l’escadron rassemblé comme s’il se fût agi des suites d’une épreuve de haies.
« Nous devrions envoyer là-bas tout de suite une autre reconnaissance et du même côté! Tout de suite! s’affairait le capitaine Ortolan décidément excité. Ces deux bougres ont dû venir se perdre par ici, mais il doit y en avoir encore d’autres derrière… Tenez, vous, brigadier Bardamu, allez-y donc avec vos quatre hommes! »
C’est à moi qu’il s’adressait le capitaine.
« Et quand ils vous tireront dessus, eh bien tâchez de les repérer et venez me dire tout de suite où ils sont! Ce doit être des Brandebourgeois!.. »
Ceux de l’active racontaient qu’au quartier, en temps de paix, il n’apparaissait presque jamais le capitaine Ortolan. Par contre, à présent, à la guerre, il se rattrapait ferme. En vérité, il était infatigable. Son entrain, même parmi tant d’autres hurluberlus, devenait de jour en jour plus remarquable. Il prisait de la cocaïne qu’on racontait aussi. Pâle et cerné, toujours agité sur ses membres fragiles, dès qu’il mettait pied à terre, il chancelait d’abord et puis il se reprenait et arpentait rageusement les sillons en quête d’une entreprise de bravoure. Il nous aurait envoyés prendre du feu à la bouche des canons d’en face. Il collaborait avec la mort. On aurait pu jurer qu’elle avait un contrat avec le capitaine Ortolan.
La première partie de sa vie (je me renseignai) s’était passée dans les concours hippiques à s’y casser les côtes, quelques fois l’an. Ses jambes, à force de les briser aussi et de ne plus les faire servir à la marche, en avaient perdu leurs mollets. Il n’avançait plus Ortolan qu’à pas nerveux et pointus comme sur des triques. Au sol, dans la houppelande démesurée, voûté sous la pluie, on l’aurait pris pour le fantôme arrière d’un cheval de course.
Notons qu’au début de la monstrueuse entreprise, c’est-à-dire au mois d’août, jusqu’en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de routes, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés… On pouvait s’y laisser approcher par l’illusion d’être à peu près tranquille et croûter par exemple une boîte de conserve avec son pain, jusqu’au bout, sans être trop lancinés par le pressentiment que ce serait la dernière. Mais à partir d’octobre ce fut bien fini ces petites accalmies, la grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d’obus et de balles. Bientôt on serait en plein orage et ce qu’on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi et on ne pourrait plus voir qu’elle: sa propre mort.
La nuit, dont on avait eu si peur dans les premiers temps, en devenait par comparaison assez douce. Nous finissions par l’attendre, la désirer la nuit. On nous tirait dessus moins facilement la nuit que le jour. Et il n’y avait plus que cette différence qui comptait.
C’est difficile d’arriver à l’essentiel, même en ce qui concerne la guerre, la fantaisie résiste longtemps.
Les chats trop menacés par le feu finissent tout de même par aller se jeter dans l’eau.
On dénichait dans la nuit çà et là des quarts d’heure qui ressemblaient assez à l’adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables, où tout était bénin, où rien au fond ne tirait à conséquence, où s’accomplissaient tant d’autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. Un velours vivant, ce temps de paix…
Mais bientôt les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour trouver le petit rabiot de sommeil dans le noir. Elle arrivait aux lignes d’avant-garde la nourriture, honteusement rampante et lourde, en longs cortèges boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d’avoine, de riz et de gendarmes et de pinard aussi, en bonbonnes le pinard, qui rappellent si bien la gaudriole, cahotantes et pansues.
À pied, les traînards derrière la forge et le pain et des prisonniers à nous, des leurs aussi, en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l’étrier des gendarmes, certains à fusiller demain, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi ceux‐là, leur ration de ce thon si difficile à digérer (ils n’en auraient pas le temps) en attendant que le convoi reparte, sur le rebord de la route – et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux, qu’on disait être un espion, et qui n’en savait rien. Nous non plus.
La torture du régiment continuait alors sous la forme nocturne, à tâtons dans les ruelles bossues du village sans lumière et sans visage, à plier sous des sacs plus lourds que des hommes, d’une grange inconnue vers l’autre, engueulés, menacés, de l’une à l’autre, hagards, sans l’espoir décidément de finir autrement que dans la menace, le purin et le dégoût d’avoir été torturés, dupés jusqu’au sang par une horde de fous vicieux devenus incapables soudain d’autre chose, autant qu’ils étaient, que de tuer et d’être étripés sans savoir pourquoi.
Vautrés à terre entre deux fumiers, à coups de gueule, à coups de bottes, on se trouvait bientôt relevés par la gradaille et relancés encore un coup vers d’autres chargements