Voyage au bout de la nuit / Путешествие на край ночи. Книга для чтения на французском языке. Луи-Фердинанд Селин
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Voyage au bout de la nuit / Путешествие на край ночи. Книга для чтения на французском языке - Луи-Фердинанд Селин страница 15
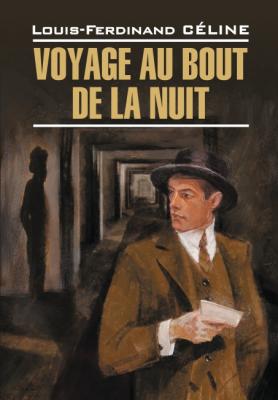 fenêtre que j’ai crié ça aussi. Ça me tenait. Un vrai scandale. « Pauvre soldat! » qu’on disait. Le concierge m’a emmené au bar bien doucement, par l’amabilité. Il m’a fait boire et j’ai bien bu, et puis enfin les gendarmes sont venus me chercher, plus brutalement eux. Dans le Stand des Nations il y en avait aussi des gendarmes. Je les avais vus. Lola m’embrassa et les aida à m’emmener avec leurs menottes.
fenêtre que j’ai crié ça aussi. Ça me tenait. Un vrai scandale. « Pauvre soldat! » qu’on disait. Le concierge m’a emmené au bar bien doucement, par l’amabilité. Il m’a fait boire et j’ai bien bu, et puis enfin les gendarmes sont venus me chercher, plus brutalement eux. Dans le Stand des Nations il y en avait aussi des gendarmes. Je les avais vus. Lola m’embrassa et les aida à m’emmener avec leurs menottes.
Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu’ils ont expliqué à l’hôpital, par la peur. C’était possible. La meilleure des choses à faire, n’est-ce pas, quand on est dans ce monde, c’est d’en sortir? Fou ou pas, peur ou pas.
Ça a fait des histoires. Les uns ont dit: « Ce garçon-là, c’est un anarchiste, on va donc le fusiller, c’est le moment, et tout de suite, y a pas à hésiter, faut pas lanterner, puisque c’est la guerre!.. » Mais il y en avait d’autres, plus patients, qui voulaient que je soye seulement syphilitique et bien sincèrement fol et qu’on m’enferme en conséquence jusqu’à la paix, ou tout au moins pendant des mois, parce qu’eux les pas fous, qui avaient toute leur raison, qu’ils disaient, ils voulaient me soigner pendant qu’eux seulement ils feraient la guerre. Ça prouve que pour qu’on vous croye raisonnable, rien de tel que de posséder un sacré culot. Quand on a un bon culot, ça suffit, presque tout alors vous est permis, absolument tout, on a la majorité pour soi et c’est la majorité qui décrète de ce qui est fou et ce qui ne l’est pas.
Cependant mon diagnostic demeurait très douteux. Il fut donc décidé par les autorités de me mettre en observation pendant un temps. Ma petite amie Lola eut la permission de me rendre quelques visites, et ma mère aussi. C’était tout.
Nous étions hébergés nous, les blessés troubles, dans un lycée d’Issy-les-Moulineaux, organisé bien exprès pour recevoir et traquer doucement ou fortement aux aveux, selon les cas, ces soldats dans mon genre dont l’idéal patriotique était simplement compromis ou tout à fait malade. On ne nous traitait pas absolument mal, mais on se sentait tout le temps, tout de même, guetté par un personnel d’infirmiers silencieux et dotés d’énormes oreilles.
Après quelque temps de soumission à cette surveillance on sortait discrètement pour s’en aller, soit vers l’asile d’aliénés, soit au front, soit encore assez souvent au poteau.
Parmi les copains rassemblés dans ces locaux louches, je me demandais toujours lequel était en train, parlant bas au réfectoire, de devenir un fantôme.
Près de la grille, à l’entrée, dans son petit pavillon, demeurait la concierge, celle qui nous vendait des sucres d’orge et des oranges et ce qu’il fallait en même temps pour se recoudre des boutons. Elle nous vendait encore en plus, du plaisir. Pour les sous‐officiers, c’était dix francs le plaisir. Tout le monde pouvait en avoir. Seulement en se méfiant des confidences qu’on lui faisait trop aisément dans ces moments-là. Elles pouvaient coûter cher ces expansions. Ce qu’on lui confiait, elle le répétait au médecin-chef, scrupuleusement, et ça vous passait au dossier pour le Conseil de guerre. Il semblait bien prouvé qu’elle avait ainsi fait fusiller, à coups de confidences, un brigadier de Spahis qui n’avait pas vingt ans, plus un réserviste du Génie qui avait avalé des clous pour se donner mal à l’estomac et puis encore un autre hystérique, celui qui lui avait raconté comment il préparait ses crises de paralysie au front… Moi, pour me tâter, elle me proposa certain soir le livret d’un père de famille de six enfants, qu’était mort qu’elle disait, et que ça pouvait me servir, à cause des affectations de l’arrière. En somme, c’était une vicieuse. Au lit par exemple, c’était une superbe affaire et on y revenait et elle nous donnait bien de la joie. Pour une garce c’en était une vraie. Faut ça d’ailleurs pour faire bien jouir. Dans cette cuisine-là, celle du derrière, la coquinerie, après tout, c’est comme le poivre dans une bonne sauce, c’est indispensable et ça lie.
Les bâtiments du lycée s’ouvraient sur une très ample terrasse, dorée l’été, au milieu des arbres, et d’où se découvrait magnifiquement Paris, en sorte de glorieuse perspective. C’était là que le jeudi nos visiteurs nous attendaient et Lola parmi eux, venant m’apporter ponctuellement gâteaux, conseils et cigarettes.
Nos médecins nous les voyions chaque matin. Ils nous interrogeaient avec bienveillance, mais on ne savait jamais ce qu’ils pensaient au juste. Ils promenaient autour de nous, dans des mines toujours affables, notre condamnation à mort.
Beaucoup de malades parmi ceux qui étaient là en observation, parvenaient, plus émotifs que les autres, dans cette ambiance doucereuse, à un état de telle exaspération qu’ils se levaient la nuit au lieu de dormir, arpentaient le dortoir de long en large, protestaient tout haut contre leur propre angoisse, crispés entre l’espérance et le désespoir, comme sur un pan traître de montagne. Ils peinaient des jours et des jours ainsi et puis un soir ils se laissaient choir d’un coup tout en bas et allaient tout avouer de leur affaire au médecin‐chef. On ne les revoyait plus ceux-là, jamais. Moi non plus, je n’étais pas tranquille. Mais quand on est faible ce qui donne de la force, c’est de dépouiller les hommes qu’on redoute le plus, du moindre prestige qu’on a encore tendance à leur prêter. Il faut s’apprendre à les considérer tels qu’ils sont, pires qu’ils sont c’est-à-dire, à tous les points de vue. Ça dégage, ça vous affranchit et vous défend au‐delà de tout ce qu’on peut imaginer. Ça vous donne un autre vous-même. On est deux.
Leurs actions, dès lors, ne vous ont plus ce sale attrait mystique qui vous affaiblit et vous fait perdre du temps et leur comédie ne vous est alors nullement plus agréable et plus utile à votre progrès intime que celle du plus bas cochon.
À côté de moi, voisin de lit, couchait un caporal, engagé volontaire aussi. Professeur avant le mois d’août dans un lycée de Touraine, où il enseignait, m’apprit-il, l’histoire et la géographie. Au bout de quelques mois de guerre, il s’était révélé voleur ce professeur, comme pas un. On ne pouvait plus l’empêcher de dérober au convoi de son régiment des conserves, dans les four-gons de l’Intendance, aux réserves de la Compagnie, et partout ailleurs où il en trouvait.
Avec nous autres il avait donc échoué là, vague en instance de Conseil de guerre. Cependant, comme sa famille s’acharnait à prouver que les obus l’avaient stupéfié, démoralisé, l’instruction différait son jugement de mois en mois. Il ne me parlait pas beaucoup. Il passait des heures à se peigner la barbe, mais quand il me parlait, c’était presque toujours de la même chose, du moyen qu’il avait découvert pour ne plus faire d’enfants à sa femme. Était-il fou vraiment? Quand le moment du monde à l’envers est venu et que c’est être fou que de demander pourquoi on vous assassine, il devient évident qu’on passe pour fou à peu de frais. Encore faut-il que ça prenne, mais quand il s’agit d’éviter le grand écartelage il se fait dans certains cerveaux de magnifiques efforts d’imagination.
Tout ce qui est intéressant se passe dans l’ombre, décidément. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes.
Princhard, il s’appelait, ce professeur. Que pouvait-il bien avoir décidé, lui, pour sauver ses carotides, ses poumons et ses nerfs optiques? Voici la question essentielle, celle qu’il aurait fallu nous poser entre nous hommes pour demeurer strictement humains et pratiques. Mais nous étions loin de là, titubants dans un idéal d’absurdités, gardés par les poncifs belliqueux et insanes, rats enfumés déjà, nous tentions, en folie, de sortir du bateau de feu, mais n’avions aucun plan d’ensemble, aucune confiance les uns dans les autres. Ahuris par la guerre, nous étions devenus fous dans un autre genre: la peur. L’envers et l’endroit de la guerre.
Il me marquait quand même, à travers ce commun délire, une certaine sympathie, ce Princhard, tout en se méfiant de moi, bien sûr.
Où nous nous trouvions, à l’enseigne